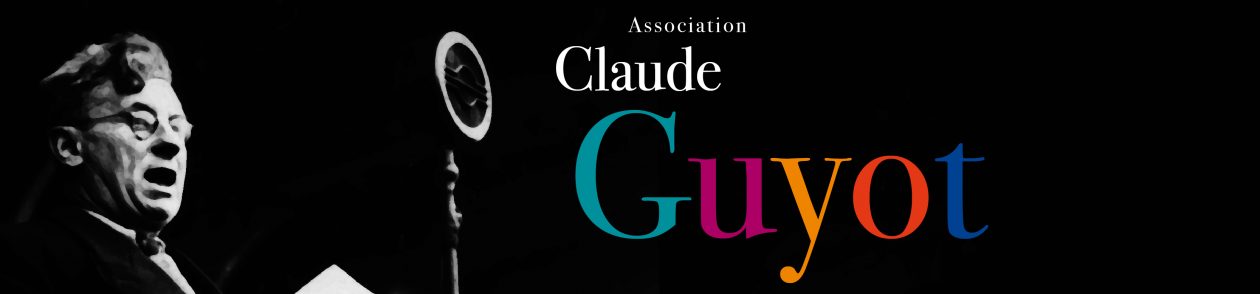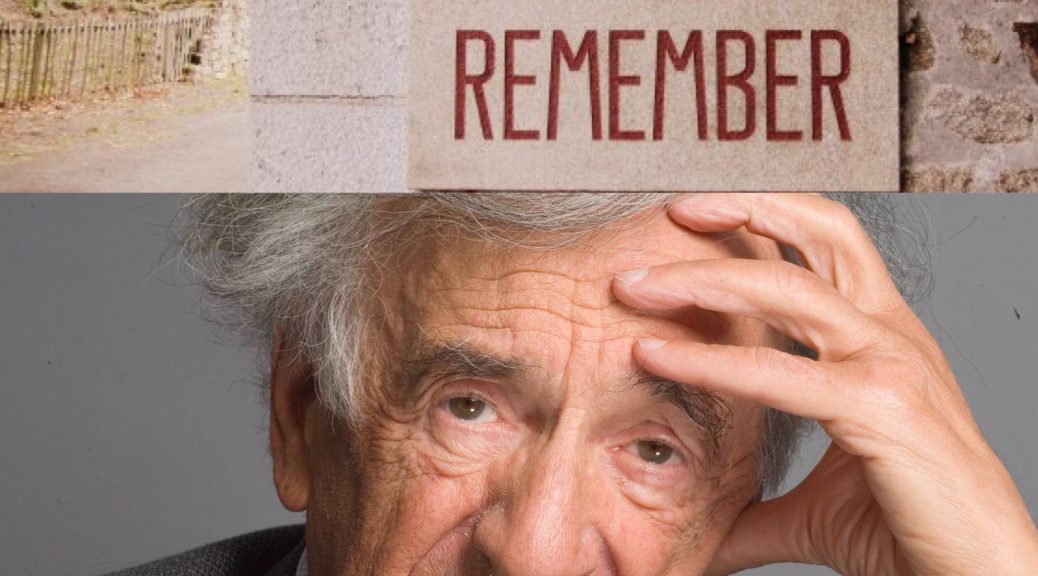Faire mémoire des atrocités de l’Histoire est-il le meilleur remède contre la guerre ?
Elie Wiesel : En vérité, la mémoire peut être une bénédiction ou une malédiction. Tout dépend de ce qu’on en fait. Je pense que les souvenirs de guerre, qui nous hantent, s’ils sont bien vécus dans leur transmission, peuvent nous empêcher de commettre certaines erreurs, nous éviter de déclencher à nouveau la guerre. Un anniversaire a quelque chose d’artificiel : on choisit le souvenir d’une certaine date, de tel événement. On a surtout besoin de structurer le souvenir. Car le passé est dans le présent : il peut l’enrichir ou l’empoisonner. Le passé peut être envahissant. Il peut même produire le chaos. Comment dégager un sens, donner une direction pour que la mémoire ouvre des possibilités de rédemption ? C’est toujours l’être humain qui doit être là pour diriger cette entreprise mentale, intellectuelle, spirituelle et métaphysique.
Vous évoquez le pouvoir rédempteur de la mémoire. Mais, en pratique, il est périlleux pour une nation de l’exercer. Comment aviez-vous apprécié, par exemple, le singulier travail de « vérité et réconciliation » entrepris par l’Afrique du Sud dès la fin de l’apartheid quand tant d’autres pays ont préféré tourner la page de leurs heures les plus sombres ?
Mandela voulait que je participe à cette commission. On a eu une longue conversation au téléphone. Mais y prendre part n’était pas compatible avec mes engagements de professeur. Cela n’aurait pas été honnête vis-à-vis de mes étudiants. Sur le fond, c’est une démarche originale et dans l’ensemble une bonne chose, qui montre le pouvoir de la confession. Le bourreau qui se confesse ne va pas en prison. Qu’en pensent les victimes de tortures ? Depuis Kant, nous savons que ce qui est bon doit avoir une portée universelle. Imaginons la même chose en 1945, avec les grands collabos, les grands tortionnaires. Klaus Barbie serait venu devant une telle commission, confessant ses crimes. Est-ce qu’on aurait marché ? C’est difficile, en même temps, de comparer deux époques. Il ne faut pas comparer avec l’Holocauste.
Comment les élus politiques doivent-ils traiter la mémoire d’un peuple ? Des lois dites mémorielles sont votées pour reconnaître ou non tel génocide, apprécier une période de l’Histoire, comme la colonisation..
Il ne faut pas politiser la mémoire, quels que soient les bords. La mémoire doit être celle qui nous unit, pas celle qui nous sépare. La politisation de la mémoire est une forme de division. La politique sert à avoir deux camps qui s’opposent. La mémoire est au-dessus.
L’essentiel, surtout, est de ne pas banaliser la mémoire. C’est un risque si on commémore trop. Il faut toujours le faire avec pudeur, avec retenue, mué par un souci de vérité, qui ne doit pas être une vérité blessante. On peut se servir du souvenir d’une guerre à de mauvaises fins, insulter l’ancien ennemi, humilier celui qui était en face. Aussi, que le chancelier allemand participe aux commémorations du Débarquement en 2004 était valable. De Gaulle et Adenauer avaient montré l’exemple. J’ai en revanche rompu mon amitié avec Mitterrand à cause de Bousquet. C’est une blessure pour moi. Le président a ensuite insisté, jusqu’au bout, pour que je l’accompagne à Berlin, où il allait saluer le courage des soldats allemands pendant la guerre. Je n’aurais pas pu cautionner un tel discours. J’aurais quitté la salle.
Quel est le devoir de la mémoire, si dénuée de finalité politique ?
Combattre l’indifférence. Je ne reconnais aucun droit à l’indifférence. C’est un principe de base pour l’humanité. Je le répète depuis des années : l’opposé de l’amour n’est pas la haine, c’est l’indifférence. L’opposé de l’éducation n’est pas l’ignorance, mais l’indifférence. L’opposé de l’art n’est pas la laideur, mais l’indifférence. L’opposé de la justice n’est pas l’injustice, mais l’indifférence. L’opposé de la paix n’est pas la guerre, mais l’indifférence à la guerre. L’opposé à la vie n’est pas la mort, mais l’indifférence à la vie ou à la mort. Faire mémoire combat l’indifférence.
Cela suffit-il dans une mondialisation économique dominée par l’argent et pouvant s’abstraire de toute morale ?
Il y a des gens pour qui l’argent doit produire plus d’argent. Mais je constate aussi que l’argent n’est pas une fin en soi pour tous. Parmi les plus grands PDG de notre temps, vous trouvez Bill Gates ou Warren Buffett qui ont donné leur fortune, des dizaines et dizaines de milliards de dollars, à des œuvres de charité ! Ce n’est pas mal.
Ne redoutez-vous pas un problème de transmission de la mémoire auprès des jeunes générations ?
Nous vivons un siècle d’information, transmise partout dans le monde. Mais entre l’information et la connaissance, il y a un abîme. Ensuite entre la connaissance et la sensibilité, il y a un abîme. Enfin entre la sensibilité et l’engagement, il y a un abîme. Éducateur ou écrivain, notre rôle est de transformer l’information en connaissance, puis en sensibilité puis en engagement, par ces quatre étapes. Depuis quarante ans que j’enseigne, je n’ai jamais donné le même cours deux fois. Mais, à la base, j’enseigne à mes jeunes étudiants l’ouverture, la sensibilité. Celui qui écoute le témoin le devient à son tour.
Votre mémoire juive repose ainsi sur le témoignage de votre père…
La mort de mon père tombe chaque année au moment du Forum économique mondial. Je dois chercher à m’isoler pour penser à lui, comment il est mort. Je ferme les yeux et me demande : que veut-il que je fasse ? Je veux rester fidèle aux engagements de mon père. Si Joseph, dans le Talmud, a la force de résister à la femme nue qui veut le séduire, c’est parce que lui revient alors en mémoire la figure de son père.
Recueilli par Sébastien MAILLARD / LA CROIX